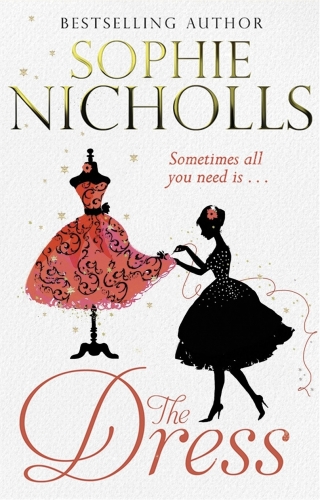Une amie m’a offert un livre qui ne pouvait que m’intéresser : Lecteur, reste avec nous ! de Maryanne Wolf (Reader, Come Home, 2018, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Nicolas Véron, 2023). Merci ! Les recherches de cette universitaire américaine, spécialiste des neurosciences, sont centrées sur la lecture et son impact sur le cerveau. Le sous-titre « Un grand plaidoyer pour la lecture » est moins précis que l’original : « The Reading Brain in a Digital World ».
Premier ouvrage en dehors des siens édité par Joël Dicker dans sa maison d’édition, il correspond bien à la devise qu’il lui a donnée : « faire lire et écrire ». Sa préface s’ouvre sur une scène dans un restaurant : à peine installés, les parents donnent des tranquillisants à leurs deux enfants. Choquant ? Quand des parents, pour avoir la paix, placent une tablette devant chaque enfant, réagissons-nous de la même façon ?
L’autrice ne manque pas d’images pour développer son sujet sous la forme de neuf lettres où elle tutoie ses « Chère Lectrice, cher Lecteur ». D’abord un rappel : la capacité à lire et à écrire, spécifique à l’homo sapiens, n’est pas pour autant innée – cela s’apprend. Observant les changements à l’œuvre dans notre monde où le numérique ne cesse de gagner du terrain, elle s’inquiète de « l’évolution du cerveau lecteur » chez les enfants, les jeunes et aussi chez les adultes qui peuvent, eux, s’aider d’une culture fondée sur l’imprimé.
Intéressée par la « plasticité du circuit neuronal de la lecture », en particulier pour une meilleure approche de la dyslexie, elle a dû prendre en compte ce « basculement culturel » que nous vivons, comparable à celui des Grecs passant de la culture orale archaïque à la culture écrite. Sa deuxième lettre explique, schémas à l’appui, le circuit de la lecture dans le cerveau, tel qu’on l’observe au stade actuel des recherches scientifiques.
Puis vient la question centrale : « La lecture profonde est-elle en danger ? » La qualité de notre lecture dépend avant tout du temps que nous lui consacrons, indépendamment du support. Les heures de lecture sur écran modifient-elles nos habitudes de lecture ? la qualité de notre attention ? Maryanne Wolf propose d’abord de nous observer nous-mêmes, comme elle l’a fait, avant de considérer ce qu’il en est pour l’apprentissage de la lecture.
« Le fait de se mettre à la place des autres, de comprendre de l’intérieur ce qu’ils pensent et ressentent, est l’un des apports les plus importants, mais aussi les plus méconnus, des processus mentaux de la lecture profonde. » Encourageant l’empathie, la lecture « élargit notre compréhension intérieure du monde » : « entrevoir, fût-ce un bref instant, ce que signifie être quelqu’un d’autre ». Qu’en sera-t-il si la lecture de romans devient marginale ?
Le « bagage émotionnel et culturel » emmagasiné lecture après lecture construit notre mémoire « interne », un véritable « support » qui nous procure des repères et des critères de jugement pour affronter la surabondance d’informations que nous recevons et faire preuve d’esprit critique. Sans ce « bagage », on est plus vulnérable face à la désinformation. « Le danger, en d’autres termes, est que nos enfants ne sachent pas qu’ils ne savent pas. »
D’un clic ou d’un réseau à l’autre, la « culture numérique contemporaine » a des effets connus : perte de concentration, addiction, « capacité réduite à supporter l’ennui », lecture « en diagonale » qui altère à la longue l’aptitude à la lecture « profonde ». D’où ce « TL, PL » (trop long, pas lu) – un titre que ses fils lui avaient suggéré – qui caractérise de plus en plus de jeunes et même d’étudiants en lettres devenus incapables de lire des chefs-d’œuvre littéraires du XIXe ou du XXe (au point que certains professeurs y renoncent et optent pour des nouvelles, ce qui ôte la difficulté de l’attention soutenue sur la longueur mais non le problème des structures syntaxiques complexes).
Parents, enseignants et responsables de l’enseignement à tous les niveaux, lecteurs, nous avons tous à apprendre de Lecteur, reste avec nous ! Maryanne Wolf, après avoir décrit les processus en jeu dans la lecture, consacre une grande partie de son « plaidoyer » à chercher comment prendre soin des enfants, quel que soit leur profil (elle en distingue six), et aux différents stades de leur apprentissage. Tous ceux qui enseignent aux enfants de cinq à dix ans devraient accorder « une attention extrême » à chacun des composants du circuit de la lecture dans le cerveau.
C’est son premier souci : faire au mieux pour que leur développement neuronal les rende aptes à la lecture profonde et « bi-compétents » vis-à-vis de l’écrit et du numérique. Parmi ses recommandations, il en est une, souvent répétée, idéale : pas d’écran avant deux ans, mais faire aux bébés, aux enfants la lecture à voix haute. Avant même d’avoir accès au langage, leur cerveau s’imprègne de phonèmes, de mots, de rythmes et de complicité affectueuse.